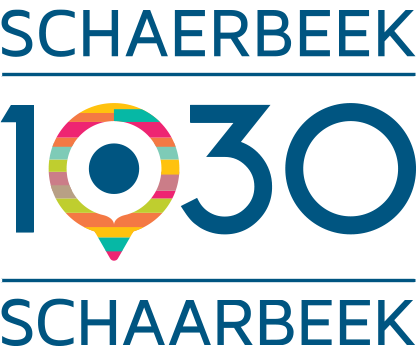Implanter une œuvre dans une commune n'est pas, pour l'artiste, le même geste que d’installer une sculpture dans une galerie, un musée. Car en rue, l’œuvre s'impose à tous, y compris à ceux qui n'en veulent pas. L'art public parle d’une époque, de ses valeurs, de ses avant-gardes ou de ses conservatismes.
A Schaerbeek, ces sculptures furent inaugurées pour la plupart il y a près de 100 ans sur une place ou sous les arbres des parcs. Les autorités communales ont choisi, à un moment donné, d’exprimer à travers les artistes des valeurs, des émotions, une identité. Aujourd’hui, nous en ignorons souvent l’histoire, les symboles, et le rôle « politique ». Restée jusqu’alors un bourg de maraichers, Schaerbeek se métamorphose à la fin du XIXème siècle et passe, entre 1865 et 1914, de 18.000 à 100.000 habitants. Au début du XXème siècle, elle n’est plus que chantiers. En observant le plan de la commune, on est impressionné par les tracés amples qui la traversent de part en part, tels l’axe royal, celui de l’avenue Rogier ou encore du Boulevard Lambermont (ancien Boulevard Militaire). Les autorités communales privilégient un urbanisme de qualité, ponctuant l’espace public de parcs, de ronds-points et de monuments.
Un vrai musée de plein air.
Entre 1890 et 1910, les élus inaugurent sans relâche sculptures et fontaines. Chaque ruban coupé rassemble les citoyens d’une commune dont l’identité se dessine, s’affirme. Les enfants des écoles sont sollicités. Par centaines, les petites écolières en robe blanche défilent et assistent aux discours d’inauguration des Bourgmestres.
La commune va essentiellement faire appel aux sculpteurs schaerbeekois pour magnifier ses places et ses parcs. Les poètes, les artistes, les hommes politiques auront tantôt un médaillon tantôt une colonne à leur honneur, rappelant aux passants l’exemple de ces grands hommes. On valorise la générosité de la commune pour les plus démunis (Monument aux Bienfaiteurs des pauvres) ou on célèbre les « Joies du Printemps » par un galop d’enfants.
Avec la guerre 14-18 le message politique véhiculé par l’art public. Le monument deviendra le lieu de la mémoire, de l’hommage aux héros morts pour la patrie.
Belle Epoque :
Le circuit commence place Colignon, à l’angle de la rue Verwée. Une fontaine – aujourd’hui asséchée - rend hommage au peintre Alfred Verwée. Elle occupe tout un pan de mur et signe l’angle. Au décès de l’artiste, Constantin Meunier et Edmond Picard se mobilisent en cherchant des fonds pour honorer sa mémoire. Inaugurée en grande pompe en 1903 en présence du Prince Albert et du Bourgmestre Kennis, le bas-relief de Charles Vanderstappen (1843-1910) honore ce peintre animalier mort à Schaerbeek en 1895. Ce taureau, qui ne semble pas effrayer la paysanne, rappelle les thèmes de prédilection du peintre mais peut-être aussi que la place Colignon était encore non bâtie quelques années auparavant.
La rue Verwée, vous mène à la place Pogge où quatre ans plus tard sera inauguré le Monument au poète flamand Emmanuel Hiel (1834-1899) sculpté par Emile Namur (1852-1908). Dans un esprit très classique, le buste du poète surplombe du haut de sa colonne de granit rose, une femme lui offrant un roseau. Des rochers assemblés confèrent à l’ensemble un semblant de pittoresque.
La rue H. Bergé vous permet de rejoindre l’avenue Louis Bertrand où trône un vase monumental en bronze baptisé Bacchanales*. Offert par Raoul Warocqué à la commune et réalisé par le sculpteur schaerbeekois Godefroid Devreese (1861-1941), il fut inauguré en 1911. Le vase marque l’emplacement du chœur de l’ancienne église Saint Servais détruite en 1905 lors du tracé de cette ample avenue menant au Parc. Il met à l’honneur le dieu Pan, entouré de nymphes : place à l’ivresse du vin et de la danse !
En descendant l’avenue vous rencontrez le Mât électrique ou Mat tigres réalisé par Jacques de Lalaing. En projet dès 1887, il ne fut fondu qu’en 1913 à l’occasion de l’Exposition universelle de Gand. La base où s’affrontent 9 tigres et des serpents dans un décor de palmiers supportait un couronnement de lampes aujourd’hui disparues. Hymne aux félins tout autant qu’à la nouvelle fée électricité, il symbolise la symbiose de l’art et de la technique. La presse de l’époque nous apprend que J. de Lalaing acheta au Zoo d’Anvers un tigre qu’il gardait en cage dans son jardin de la rue Ducale ! Le mât sera offert à la commune en 1926 par les héritiers du sculpteur. Aujourd'hui classé sa restauré est lancée.
Au-delà du pont du chemin de fer, pénétrez dans le parc Josaphat, espace verdoyant aménagé par Edmond Galoppin (1851-1919) en 1904. Un médaillon de Jean Lecroart apposé sur un rocher « rustique » rend hommage à ce grand paysagiste. Ancienne propriété privée, ce jardin à l’anglaise doit son nom à sa ressemblance avec la vallée Josaphat en Palestine.
L’hommage aux artistes :
Avec pour arrière plan l’enfilade des maisons de l’avenue des Azalées, la promenade en direction des étangs est jalonnée de différentes sculptures et médaillons qui rappellent aux promeneurs le souvenir des grands artistes. A la même époque, la commune choisit de baptiser un quart de ses rues du nom d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un écrivain.
A l’ombre d’un sapin, vous découvrez le buste d’Emile Verhaeren, qui l’arpenta maintes fois (sculpteur Louis Mascré 1871-1929 – inauguré en 1928).
A quelques pas du joli pigeonnier le dramaturge Nestor de Tière (1856-1920) de Frans Huygelen (1878-1940) fait face au peintre Léon Frédéric (par Jules Lagae 1862-1931). Léon Frédéric vécut longtemps chaussée de Haecht, dans un atelier aujourd’hui disparu. La commune possède de très belles œuvres de cet artiste aux frontières du symbolisme et de la peinture sociale.
Le Parc, musée à ciel ouvert :
Le sculpteur Albert Desenfans (1845-1938) réalisera deux œuvres pour ce parc : Eve et le serpent (1890) offerte par le Gouvernement belge ainsi qu’un Elagueur (1895) qui semble guetter les branches mortes aux alentours.
Si le Parc d’Egmont s’enorgueillit d’une sculpture de Peter Pan, le Parc Josaphat abrite une autre héroïne de conte : une petite Cendrillon, tenant un soufflet, sculptée par Edmond Lefever (1839-1911).
Depuis près de 100 ans, Le Dieu Borée (1904-1906) du sculpteur Joseph Vandamme souffle du haut de son rocher sur l’étang du Parc.
Quelques monuments marquent encore l’histoire de commune. L’avenue Rogier traverse Schaerbeek de part en part, ponctuée de petites places, elle est coupée à mi-parcours par un imposant rond-point : Le « Monument aux Bienfaiteurs des Pauvres ». Cette fontaine est inaugurée en 1907 accompagné d’un incroyable défilé des écoles. L’œuvre fut réalisée par le sculpteur schaerbeekois Godefroid Devreese (voir Vase Bacchanales*) avec – pour la fontaine et le socle - la collaboration de l’architecte Art Nouveau Henri Jacobs à qui l’on doit quelques-unes des plus belles écoles bruxelloises et celle de Maurice Van Ysendijck, qui reconstruisit l’Hôtel communal après l’incendie. Cette allégorie de la Charité protégeant le vieillard et l’enfant est complétée d’une paysanne schaerbeekoise qui rassemble ses choux dans un panier.
Les monuments du souvenir
La guerre de 1914-1918 fera apparaître une série de monuments aux morts. Les artistes sont sollicités pour entretenir le souvenir du carnage et honorer le courage de ceux qui y perdirent la vie.
La guerre 40-45 suscitera moins de monuments commémoratifs. A certains endroits, le monument aux morts de la guerre 14-18 se voit complété. C’est aussi le moment où se crée un fossé plus large entre l’académisme qui caractérise souvent une certaine statuaire commémorative et l’engagement des artistes vers l’abstraction et d’autres avant-gardes.
A Schaerbeek, le 1er novembre, les patriotes et les autorités communales font le tour de tous les monuments et les fleurissent honorant la mémoire des anciens combattants, des résistants, des prisonniers et déportés.
Quelques-uns sont évoqués : Fernand Gysen (1879-1943) va sculpter un Mémorial aux 2509 carabiniers et carabiniers cyclistes morts pour le Roi et pour la Patrie pendant la guerre 1914-1918. Ce monument qui fut initialement intégré dans la caserne Prince Baudouin, place Dailly, sera déplacé ensuite au bas de l’avenue Louis Bertrand en bordure du parc Josaphat.
Le « Monument aux morts du Génie » de Charles Samuel 1862-1938), aujourd’hui Square Vergote, rappelle à quel point ce corps (aérostiers, pontonniers, télégraphistes cyclistes…) perdit des hommes durant la guerre. Vous connaissez sans doute, du même sculpteur, la Brabançonne place Surlet de Chokier ou le Monument à Charles de Coster et son Thyl Uilenspiegel devant les étangs d’Ixelles. Le monument aux morts du Génie fut installé en 1957 sur le square Vergote. Situé précédemment sur la Place de l’Yser, il dut être déplacé lorsque l’on construisit le viaduc au dessus du boulevard Léopold II.
Le mémorial aux fusillés de Georges Vande- Voorde (1878-1964) situé à l’angle du boulevard Reyers et de la place des carabiniers fut installé en 1956, plus de 10 ans après la fin de la guerre. Deux hommes et une femme sont attachés au poteau d’exécution. Il nous rap- pelle que derrière la rtbf (via la rue du colonel bourg à la hauteur du n°102) on peut découvrir un lieu de mémoire très peu connu.
L’enclos des fusillés. Cet espace est ce qui reste de l’ancien tir national, ancien stand de tir de l’armée utilisé par les allemands durant les deux guerres pour fusiller les résistants telles les grandes figures de Edith Cavell, Gabrielle Petit (à qui un monument est consacré au cimetière de Schaerbeek à Evere) ou Philippe Baucq (qui possède également sa sculpture au parc Josaphat). L’enclos des fusillés abrite 365 tombes de résistants fusillés.
Chaque dernier dimanche d’avril, se tient à l’enclos des fusillés la manifestation nationale d’hommage aux rescapés des camps de concentration et prisons nazis, en présence des plus hautes autorités du pays.