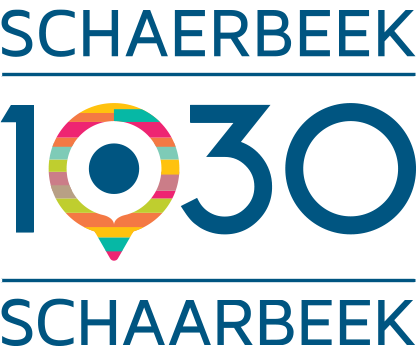Lieux-dits & petites histoires des rues
Vous vous demandez ce qui se cache derrière le nom de telle ou telle rue ? Cette petite histoire des rues de Schaerbeek est faite pour vous.
La commune de Schaerbeek compte aujourd’hui un peu plus de 300 rues. Si certaines dénominations illustrent clairement l’histoire locale, d’autres rendent hommage aux personnages - célèbres ou non - qui vécurent dans la cité des ânes ou firent sa renommée.
En raison surtout de son passé artistique et littéraire particulièrement florissant, Schaerbeek a fait la part belle aux artistes (écrivains, peintures, sculpteurs, musiciens,…) en baptisant pratiquement un tiers de ses rues en leur honneur. Nous vous invitons à les découvrir en parcourant le quartier des artistes, autour de la place des Bienfaiteurs, le quartier des écrivains, autour de l’avenue Huart-Hamoir, le quartier des artistes flamands du XVIIe siècle, autour de l’hôtel communal,…
Les autres personnalités ne sont pas oubliées. Qu’il s’agisse de politiciens, industriels, ingénieurs, avocats, architectes, médecins,… tous vous révèleront un pan de l’histoire de Schaerbeek.
Enfin, n’hésitez pas à faire un détour par le quartier des fleurs, de part et d’autre du parc Josaphat, et le quartier des pierres précieuses, près du square Plasky.
Né à Gand en 1862, décédé à Nice (France) en 1949. Ecrivain, poète et dramaturge belge d’expression française. A obtenu le Prix Nobel de littérature en 1911. Fut le premier écrivain belge de langue française à conquérir la célébrité mondiale. Auteur, entre autres, de Pelléas et Mélisande.
Né à Molenbeek-Saint-Jean en 1854, décédé à Bruxelles en 1896. Capitaine à l’École Royale Militaire où il était répétiteur de géométrie et d’astronomie. Démissionna en 1888 pour devenir directeur général de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite (1890-1896). Mahillon étant l’un des promoteurs des habitations sociales en région bruxelloise, le Foyer schaerbeekois propose, en 1902, que cette rue soit dénommée en son honneur.
Né à Ename en 1847, décédé à Schaerbeek en 1915. Fonctionnaire. Fut conseiller communal à Schaerbeek (1908-1915) et échevin à Schaerbeek (1915).
Né à Saint-Josse-ten-Noode en 1836, décédé à Schaerbeek en 1901. Lieutenant-général dans l’armée belge en 1897. Prit part à la campagne du Mexique où il fut blessé à l’épaule.
Né à Anvers en 1920, décédé à Schaerbeek en 1993. Artiste peintre et écrivain belge d’expression française ayant vécu à Schaerbeek. Membre du groupe des surréalistes belges, il a beaucoup écrit sur cette tendance artistique. Son œuvre picturale se compose essentiellement d’assemblages et de collages, souvent agressifs, qui ne manquent pas de surprendre, voire de choquer.
Né à Anvers en 1824, décédé à Schaerbeek en 1906. Artiste peintre belge formé à l’académie des Beaux-Arts d’Anvers sous la direction de Gustave Wappers. A notamment peint des sujets historiques et religieux, des tableaux de genre et des portraits. Constamment enthousiasmé par l’idéal romantique. Pendant plus de dix ans, en sa qualité de conseiller communal à Schaerbeek, il a coopéré à l’embellissement de la commune. Habitait à Schaerbeek, chaussée de Haecht 129 puis 155.
Anciennement rue d’Autriche, elle fut rebaptisée en rue de la Marne en 1918 en souvenir de la glorieuse bataille, en 1914, qui sauva Paris de l’occupation.
Né à Bruxelles en 1773, décédé à Saint-Josse-ten-Noode en 1830. Notaire. Sous le régime français, en 1807, il succéda à Goossens comme maire de Schaerbeek. Il fut déchu de ses fonctions en 1808. Anciennement dénommée Petite rue Philomène.
Né à Bruxelles en 1798, décédé à Bruxelles en 1860. Combattant de 1830. Ingénieur à l’administration communale de Bruxelles, il fut chargé de la surveillance de l’achèvement du canal de Bruxelles à Charleroi. Devint, en 1838, premier directeur général des chemins de fer belges et, en 1850, directeur des postes.
Né à Schaerbeek en 1868, décédé à Saint-Josse-ten-Noode en 1930. Conseiller communal à Schaerbeek (1902-1919) et échevin à Schaerbeek (1903-1919). Fut aussi député permanent du Brabant (1919-1930). Créa avec le Lycée Emile Max le premier lycée communal pour jeunes filles du pays.
Né à Schaerbeek en 1813, décédé à Schaerbeek en 1902. Agriculteur. Fut conseiller communal à Schaerbeek (1861-1875) et échevin à Schaerbeek (1861-1863). Fut également capitaine de la 6ème compagnie de la garde civique de Schaerbeek.
Né à Saint-Josse-ten-Noode en 1857, décédé à Schaerbeek en 1940. Général-major dans l’armée belge en 1914. Gouverneur militaire du Brabant en 1918. Conseiller communal à Schaerbeek (1921-1939), échevin à Schaerbeek en 1927 puis bourgmestre de Schaerbeek (1927-1938).
Né à Schaerbeek en 1872, décédé à Schaerbeek en 1924. Artiste peintre belge formé à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles. A peint surtout des paysages et des vues citadines. Sa palette initialement assez sombre s’éclaircit petit à petit après quelques séjours effectués en France. Réalisme spontané et limpide réalisé avec des coups de pinceaux vigoureux. Cofondateur du cercle " Le Labeur ". Habitait à Schaerbeek, rue des Coteaux 279 puis avenue Albert Giraud 20.
Né à Louvain en 1466, décédé à Anvers en 1530. Artiste peintre belge.
Né à Liège en 1847, décédé à Schaerbeek en 1898. Sculpteur belge formé à l’académie de Liège. S’installe en 1876 dans les environs de Paris en compagnie de Paul Devigne puis se fixe définitivement à Bruxelles en 1884. Œuvres animalières présentes au Jardin Botanique à Bruxelles. Habitait à Schaerbeek, rue des Coteaux 35 puis rue du Progrès 224. Son atelier était situé rue Albert de Latour 30.
Né à Braine-le-Comte en 1828, décédé à Schaerbeek en 1906. Notaire. Colonel de la garde civique, commandant le secteur de Schaerbeek (1868-1888).
Nom donné au quartier de la gare de Schaerbeek. En 1690, une maison de plaisance est construite sur les bords de Senne par Pierre-Ferdinand Roose, baron de Bouchout. Au milieu du XVIIIe siècle, le petit château est alors la propriété de Jérôme de Tassilon qui loue son domaine à Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. C’est à ce prince que nous devons l’appellation Monplaisir qui allait rester attribuée au quartier car il aimait particulièrement cet endroit où il y organisait fêtes galantes et chasses à courre.
En souvenir du domaine de Monplaisir, dont le château, construit en 1690, était situé au rond-point de l’avenue Huart-Hamoir. Ce domaine fut loué de 1752 à 1780 à Charles de Lorraine qui y organisa des parties de chasse. En 1786, le château servit de siège à la fabrique de porcelaine Monplaisir, très célèbre. Il fut démoli en 1907 pour permettre l’aménagement d’un nouveau quartier.
Appellation donnée autrefois au quartier Dailly. Au Moyen Age, le Maelbeek traversait cette vallée et s’y décomposait en plusieurs étangs et mares. Deux de ces pièces d’eau étaient nommées par les villageois « Kleine Troostvijver » et « Grote Troostvijver ». Le mot « Troost » était alors une version abrégée par un usage courant de « ter roost », la jonchaie, dû probablement aux roseaux qui entouraient ces étendues d’eau (vijver). Au milieu du XIXe siècle, au moment où le quartier fut réaménagé, les autorités communales décidèrent de s’inspirer de ces anciennes appellations pour nommer deux nouvelles artères. C’est ainsi que la rue de la Consolation résulte erronément d’une mauvaise interprétation de « Troost ». De même, la « Roostberg », montagne de la jonchaie, devenue avec le temps « Roosberg », fut naturellement traduite par « Mont Rose » et adjugée à une rue perpendiculaire à celle de la Consolation. « Mont Rose » devint également très vite « Monrose », faisant ainsi écho au quartier Monplaisir.
En 1880, fut publié un plan topographique de Schaerbeek qui mentionnait le quartier Mont-Rose. L’origine du nom Monrose vient probablement, tout comme la rue de la Consolation (voir ce nom), d’une déformation du vieux flamand bruxellois « roost », càd la rosière, pièce d’eau entourée de roseaux. Bordant les étangs formés par le Maelbeek on trouvait également un versant abrupt appelé depuis longtemps Roosberg, « montagne des roseaux ». Après traduction, le nom se transforma en un poétique Mont-Rose. L’influence de « Monplaisir » (voir ce nom) fit perdre son « t » au Mont-Rose.
Appellation d’un chemin qui devait son nom au fait qu’il traversait à mi-côte des bancs de silex caractéristiques du sous-sol bruxellois. Cette voie caillouteuse partait de ce qui est actuellement la rue Teniers, franchissait la vallée Josaphat au niveau de ce qui est maintenant la plaine du tir à l’arc, et se prolongeait jusqu’à la présente rue Guillaume Kennis.